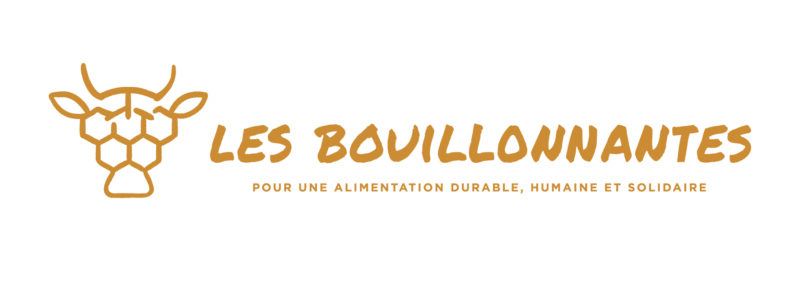Porté par l’envie d’imaginer un modèle alimentaire alternatif au modèle actuel dominant, Thomas Ravard a créé en 2019, à La Chapelle-sur- Erdre, au cœur de la métropole nantaise, une micro-ferme de moins de 2 hectares sur des terres inutilisées jusque-là, où il cultive entièrement à la main une diversité de légumes en agriculture biologique.
Si, pendant le confinement, il a vu son activité grandir avec la demande croissante des citoyens venus s’approvisionner directement à la ferme ou souscrivant à des contrats d’AMAP, il regrette que cet élan ne se soit pas poursuivi depuis et encourage chacun à s’emparer des enjeux de son alimentation.
De l’élevage au maraîchage
Fils de paysans, Thomas a vu ses parents forcés de cesser leur activité, subissant un modèle agricole contraignant, peu rémunérateur et destructeur de leur santé. « Mes parents étaient agriculteurs à Saint-Lyphard, en Brière. J’avais 10 ans quand ils ont arrêté. J’ai grandi mes 10 premières années dans une ferme puis on a déménagé à Saint-Julien-de-Concelles, au cœur du bassin nantais du maraîchage intensif. J’ai toujours été attiré par l’agriculture. J’ai suivi le modèle classique en faisant un bac agricole puis un BTS en un an. Entre-temps, j’ai bossé deux ans pour me faire la main. J’ai fait un peu de maraîchage et j’ai travaillé pour une entreprise de travaux agricoles. Nous intervenions pour les agriculteurs, les viticulteurs et les communes avec des tâches très diverses comme les battages, les ensilages, les vendanges ou l’épandage de fumier l’hiver. Initialement, mon projet était de m’installer en élevage de chèvres et d’ouvrir une ferme pédagogique. En sortant de mon BTS, j’ai aussitôt trouvé un travail dans une ferme en bio laitière où je suis resté quasi 10 ans. 3 à 4 ans avant de partir, j’ai commencé à chercher une ferme où m’installer. J’en ai visité beaucoup. Puis, mon frère s’est greffé au projet avec l’idée d’allier une activité de maraîchage à l’élevage. Initialement, on voulait être près de la côte… mais l’accessibilité au foncier était très compliquée. On a finalement trouvé une ferme à La Chapelle-Basse-Mer grâce à l’association Terre de Liens (qui accompagne les nouveaux paysans sur l’acquisition ou la mise à disposition de terres). Les cédants étaient des personnes qui, bien qu’ils soient au plein cœur de la vallée maraîchère industrialisée, étaient convaincus par l’agriculture biologique et souhaitaient préserver cette petite structure. Le projet défendu par Terre de Liens correspondait à une activité maraîchère. J’y suis allé en me disant que par la suite, je pourrai greffer des animaux et des petites activités pédagogiques. Nous nous sommes donc installés tous les deux en maraîchage bio directement. »
Malheureusement après 5 ans, les deux frères ne parviennent plus à travailler ensemble. « Même avec des envies communes, ça peut être compliqué de collaborer. J’ai donc fait le choix de me réinstaller seul. J’ai mis 2 ans à trouver mon lieu. J’ai récupéré une parcelle de prairie d’un hectare. Ce n’était pas une ferme. J’ai identifié cet espace un peu par hasard en recherchant des structures libres autour de Nantes. »
Soutenu par la municipalité de la Chapelle-surErdre qui cherche à installer de jeunes agriculteurs sur sa commune et remettre en culture certaines parcelles, Thomas pose ses valises en 2019 sur ces terres situées non loin du périphérique nantais. « Il y a beaucoup de communes qui cherchent à remettre en culture certaines parcelles, mais on sait que certaines parcelles ont été délaissées pour des raisons agronomiques. Je n’ai pas fait d’analyse. Je fonctionne à l’observation. En observant les végétaux qui poussaient naturellement, je savais à quoi m’attendre. C’est une terre plus adaptée pour faire des pommes que des légumes, car elle est très lourde, très limoneuse. J’ai fait le choix d’y aller en connaissance de cause. Je savais que je ne pouvais pas faire tous les légumes à tous les endroits. La terre est très hétérogène. »

Autour de cette parcelle, la vallée compte bon nombre d’hectares non utilisés qui eux aussi pourraient être cultivés. « J’ai plusieurs formes d’utilisation de ces terres, de la location mais aussi de la mise à disposition sans bail rural sur des terres que les propriétaires ne veulent pas louer car ils imaginent probablement qu’elles deviendront un jour constructibles. Ces parcelles, je m’engage à les entretenir le plus proprement possible. Les cultures qui sont en place sont belles ! »
Pour Thomas, ne pas être propriétaire des terres qu’il cultive sonne presque comme une évidence « Je suis locataire de tout, à part mon petit matériel. Je suis seulement de passage pour cultiver ces terres. Je demande juste à vivre de mon métier. Je me suis installé avec seulement 30 000 €. L’idée, c’était de monter une micro-ferme qui puisse être rémunératrice sans pour autant nécessiter de gros investissements ni de gros crédits. En ayant conscience que je peux être dans l’obligation d’arrêter mon activité et que s’il y a des crédits alors, ça peut s’avérer compliqué. Quand on produit des légumes, il n’y a pas beaucoup de valeur ajoutée. C’est très éphémère, donc il ne faut pas trop se charger en investissement. Par ailleurs, je n’ai pas voulu investir 30 000 € dans un forage et un système de pompes. Je suis branché sur le réseau d’eau courante. Mais j’ai raisonné toute mon irrigation avec du goutte-à-goutte, des micro-aspersions et surtout du paillage avec l’objectif d’optimiser ma consommation. Aujourd’hui, ça me coûte 4 000 € par an d’eau. C’est une contrainte pour la ferme. Mais de cette contrainte naît une manière de faire. Je vois les choses comme ça. C’est à moi d’être suffisamment malin pour que ça fonctionne et devienne une force. »
Un métier porteur de sens
Les contraintes du métier, Thomas les accepte grâce au soutien des clients de la ferme et de leur engagement. « On se débrouille souvent de bric et de broc. J’accepte cela, mais je sais que ça n’est pas donné à tout le monde. J’ai vu mes parents arrêter. J’ai une certaine sensibilité aussi à la rudesse du métier. Il y a une forte valeur travail dans mon éducation. Mais outre l’envie d’entreprendre, il y a aussi l’envie de se passer des codes et des lois. Sortir de la norme et voir le champ des possibles, ça m’anime. J’aime le sol, le vivant. C’est porteur de sens pour moi. Notre capacité à réussir dépend de notre flexibilité. L’énergie, je l’acquière au contact du vivant et des clients qui viennent me remercier. Semer un produit, le manger et nourrir son enfant avec, c’est stimulant. »
Dès sa première expérience, les circuits courts lui ont ainsi permis de trouver un sens plus large à son métier. « Quand je travaillais avec mon frère, j’ai découvert la relation qu’on peut nouer avec les clients. On bénéficie d’un soutien moral. Il y a de vrais liens qui se créent, voire des amitiés. On se doit d’être honnête avec eux. À chaque fois que je cueille un légume, je peux quasiment mettre un visage et un sourire derrière. Je ne peux pas tricher. Je suis au cœur de leurs repas, donc je me dois d’être exigeant avec moi-même et avec la qualité des produits que je propose. Ça amène une jolie dimension à ce métier. Je trouve ça beau ! »


En s’installant à la Chapelle-sur-Erdre peu avant le confinement, Thomas a pu à nouveau bénéficier de ce circuit de vente : « Quand il y a eu les restrictions pour les restaurants et les écoles, j’étais en place, avec des légumes en stock. Les particuliers ont alors répondu présents. Ça a donné un bon élan à la ferme avec une augmentation du chiffre d’affaire qui n’était pas négligeable. En 3 jours, je suis passé de 20 paniers hebdomadaires à 150 paniers. Par chance, j’ai quelques amis et voisins qui sont venus m’aider. À la sortie du confinement, nous étions 6 sur la ferme. Il y avait 3 salariés et 2 apprentis en plus de moi. Sur une superficie de 2 ha. L’année dernière, je suis retombé à 2 salariés à temps plein. Désormais, je suis seul. Je me fais aider ponctuellement sur les jours de récolte ou via des chantiers participatifs. Suite au désengagement des adhérents des AMAP, nous sommes passés de 90 paniers à moins de 50 actuellement. Certains n’ont pas renouvelé, d’autres ont déménagé… Globalement il y a une baisse de fréquentation des AMAP, plus particulièrement pour celles qui se sont montées rapidement pendant le confinement. C’est très frustrant. Je licencie des gens parce que je n’arrive pas à les payer alors que nous sommes aux portes de Nantes. Certes, il y a eu 3 installations en maraîchage sur la commune, mais on devrait être plus nombreux encore pour nourrir ce bassin. On ne pourra pas y arriver tout seul. Je tente de me réinventer, mais j’ai besoin aussi que les citoyens s’engagent et se demandent quelle agriculture ils veulent défendre. Ça nécessite que chacun fasse un minimum d’effort pour s’approvisionner autrement. »
La conviction du bio
Cet engagement, pour Thomas, il passe avant tout par le choix d’une agriculture biologique respectueuse du vivant. « Je suis convaincu par la bio. Mon père a un cancer reconnu par la MSA suite aux utilisations de produits chimiques dans les années 1980-1990. J’ai toujours souhaité produire autrement. Le label amène cette transparence et permet aux gens de faire confiance aux producteurs quant à la non-utilisation de produits chimiques. Il faut qu’on arrive à le faire savoir plus largement et à sensibiliser chacun à ces enjeux. Je crois profondément que l’alimentation doit revenir à son usage premier qui est de soigner et de donner du plaisir. D’ailleurs, on constate souvent que les jeunes parents se mettent au bio avec l’arrivée d’un enfant. Je crois beaucoup au fait de sensibiliser les enfants depuis leur plus jeune âge. Il m’arrive sur la ferme de voir des gamins qui ont été sensibilisés à cela et qui vont s’extasier devant une betterave ou qui ne vont pas hésiter à croquer dans un fenouil cru. Je m’en réjouis ! »
Pour maintenir les équilibres, Thomas utilise certains amendements. « Dans un bilan azoté, on regarde ce qu’on exporte du sol et on remet en fonction des besoins de la future plante. Avant mon arrivée, la parcelle était fauchée, mais la matière était exportée, donc elle s’est épuisée. J’ai donc fait des apports de fumier selon le besoin des plantes et ce que j’observais. Aujourd’hui, je mets une fertilisation pour 3 cultures de légumes différentes ensuite. J’amende en fumier, puis je mets une culture plutôt gourmande comme le chou, les pommes de terre, les poireaux, les tomates ou les légumes d’été, ensuite j’enchaîne avec des légumes racines (betteraves, carottes, radis…) qui vont manger le reliquat et enfin avec les feuillages (salades, fenouil, fines herbes…). Il est difficile de trouver du fumier à acheter localement. J’achète une composition de fumier sous la forme de granulés. Ça simplifie la tâche d’épandage. »
Si les ravageurs lui rendent visite parfois, il se refuse à utiliser tout traitement ou la mise en place de population d’insectes pour lutter contre eux. « Je suis bien entouré en termes d’arbres, il y a beaucoup de vie autour. Ça permet d’avoir des corridors écologiques pour héberger la faune et donc les prédateurs de nos ravageurs. Ça amène aussi du gibier. Mais je pars du principe que c’est moi qui m’invite chez eux. »

Le Chou-fleur
Parmi les légumes qu’il affectionne particulièrement, le chou-fleur occupe une place particulière. « J’aime particulièrement la culture de ce légume, notamment le chou-fleur violet et le romanesco. Comme pour l’ensemble de mes légumes, je cherche au maximum des semences de plantes endémiques du terroir et j’évite les hybrides. Je sème des choux-fleurs, mais j’achète aussi des plants, car le chou-fleur se sème en juin, au moment où il y a des altises, un petit insecte qui grignote ses feuilles. Je fais volontairement arriver mes choux-fleurs un peu plus tard que ce que beaucoup font. Autrement, je manque de variétés pour remplir mes paniers en fin de saison. En principe, je peux tenir jusqu’aux grosses gelées de février. En novembre, pour les premières gelées, ils sont encore petits, donc pour les protéger du froid, je referme les feuilles sur eux avec un élastique. Le dérèglement climatique amène des fluctuations de l’ordre de 15 jours dans les saisons. L’année dernière, j’ai perdu la moitié de ma production suite aux gelées tombées précocement. C’est de plus en plus compliqué de prévoir la bonne période pour semer. Mais je tiens avant tout à respecter les saisons naturelles du légume. Dès qu’on cherche à contourner ça, à industrialiser le vivant, c’est là qu’on rencontre des problématiques ! »
Outre les AMAP et le retrait à la ferme, ces choux-fleurs et les autres légumes de Thomas sont livrés également dans les entreprises, à une dizaine de restaurateurs nantais et à la cuisine centrale de la commune. « Ça été très fastidieux à mettre en place cette collaboration avec les cantines. Ça dépend avant tout d’une volonté politique et du budget alloué, mais aussi du personnel, s’il est formé ou non, des équipements internes des cuisines et de la personne en charge des menus. Ça représente beaucoup de contraintes pour les petits producteurs. On aimerait parfois que les menus soient plus souples et prennent plus en compte nos productions. »
Certes, il regrette aujourd’hui de devoir travailler seul, « C’est un métier passionnant, mais la charge de travail peut être vite conséquente. On est plus efficace à plusieurs et c’est plus plaisant en termes d’ambiance. » et de ne bénéficier d’aucune aide « Je ne bénéficie pas des aides de la PAC (Politique Agricole Commune). Nos petits modèles économiques sont souvent oubliés des programmes d’aides.» Mais Thomas reste optimiste « Il faut continuer à se dire que chacun peut contribuer par son acte d’achat et ainsi participer au monde de demain. C’est là qu’est le vrai enjeu de demain ! Il ne faut pas voir que l’aspect financier. Et d’ailleurs, nous ne sommes pas plus chers que les autres. Mais, est-ce qu’on peut vraiment faire de l’argent avec la nature ? Est-ce que la nature est appropriée à notre modèle économique qui voudrait que, grâce à elle, on crée une rémunération ? Est-ce qu’on doit se reposer sur l’investissement des paysans juste parce qu’ils aiment ce qu’ils font ? On pourrait aussi ne pas compter et fonctionner autrement, mais alors, il faudrait que chacun joue le jeu ! »