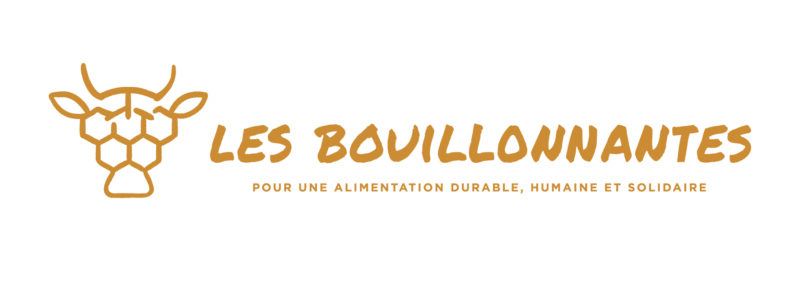Quatrième génération à fouler ces terres, voilà plus de 20 ans déjà que Hervé Hunault et Thierry Chantebel, cousins, ont repris et réuni les fermes voisines de leurs parents, situées dans le pays de Châteaubriant, à cheval entre les départements de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire.
Ils y ont mis en place un modèle vertueux de polyculture qui allie l’élevage d’une soixantaine de vaches de race Rouge des Prés et culture de céréales, oléagineux et légumineuses.
Évènement La Grande Semaine Végétale : Déjeuner-rencontre chez Chacha avec Vivien d’Anjou
Polyculture et agriculture biologique
À leur arrivée, en 2000, les deux cousins héritent du troupeau de vaches allaitantes des parents de Hervé. « On a d’abord commencé en poursuivant le modèle existant de nos parents, notamment en vendant la viande à travers les circuits classiques : boucheries conventionnelles, supermarchés… Mais on ne s’y retrouvait pas. D’un côté, ça nécessitait des investissements importants, de l’autre le marché était trop peu valorisant. C’est en découvrant notamment les bénéfices du régime crétois que la décision est venue d’abandonner le tourteau industriel pour une alimentation de qualité, plus riche en Oméga 3. Nous avons alors commencé à produire du lin et de la luzerne. Nous avons été parmi les premiers à rejoindre l’association Bleu Blanc Cœur pour sa démarche nutrition où nous sommes restés adhérents pendant 15 ans. »
En effet, le régime crétois préconise l’utilisation d’ingrédients riches en Oméga 3, comme l’huile de colza, le lin, le lupin… mettant en exergue le fait que le déséquilibre entre des apports trop importants en Oméga 6 et ceux trop faibles en Oméga 3, provoqué par nos régimes habituels et par les filières classiques d’alimentation des animaux, participent à de nombreux problèmes de santé (obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, certains cancers…).
Dès lors, la ferme entame progressivement sa transition, augmente son autonomie, diversifie les cultures, modifie ses réseaux de vente pour favoriser les circuits courts et le local, et entreprend sa conversion en agriculture biologique en 2016. « Moi, j’étais prêt depuis longtemps, explique Hervé, Thierry lui ne l’était pas. Jusqu’au jour où il a été malade pendant six mois. Il a passé une batterie de tests et il s’est dit que très probablement, cette maladie que personne ne savait justifier était liée aux produits phytosanitaires. Il a donc pris la décision de la conversion. Il s’est auto-formé. Ce n’est pas la même façon de pratiquer le métier. Mais du jour où il a arrêté d’utiliser
les produits phytosanitaires, il n’a plus été malade. »
La ferme se veut aussi être entièrement autonome sur l’alimentation des animaux. « Nos vaches sont dehors toute l’année. Elles sont nourries avant tout avec l’herbe de nos parcelles et, en complément, avec tous les déchets de nos céréales, légumineuses, tout ce qu’on ne peut pas vendre en alimentation humaine. Nous n’avons aucune culture dédiée aux animaux, elles n’ont que des déchets. Mais de bons déchets ! »
Ce modèle, c’est celui de la polyculture-élevage et de l’association intelligente de la conduite d’un troupeau en système herbager aux cultures végétales. Pour ce faire, Hervé et Thierry pratiquent une rotation longue sur les 180 ha que compte la ferme, répartis équitablement entre 90 ha d’herbages et 90 ha de grandes cultures. « Nous avons une rotation de culture sur des cycles de 10 ans. Les vaches fertilisent les prairies pendant 5 ans, avant qu’elles soient mises en culture. C’est la force de la ferme ! Ensuite, pendant 5 ans, nous alternons des cultures de printemps et des cultures d’hiver en essayant au maximum d’enchaîner celles-ci ou, sinon, d’utiliser un couvert végétal afin ne pas avoir trop de pression de mauvaises herbes. Selon les cultures, le temps de pousse peut aller de 5 à 11 mois. »



Une grande diversité de cultures
Si Hervé et Thierry ont commencé au début sur un fonctionnement avec des rotations classiques : blé / maïs / colza, au fil des années, la liste des cultures n’a cessé de s’étendre et compte désormais blé, orge, avoine, épeautre, sarrasin, féveroles, colza, tournesol, maïs pop corn, moutarde (brune et blonde), lentilles (vertes, noires, corail, blonde), haricots (blancs, noirs, rouges, borlotto, pinto, lingots…), fèves, soja, lupin, pois chiches, quinoa, cameline, lin…
« Chaque année, nous testons de nouvelles choses. C’est aussi le fruit de discussions avec nos points de vente. Les épiceries nous demandent si on fait tel ou tel produit. Ça nous donne souvent envie d’essayer, tout en prenant en compte l’intérêt que ça va apporter dans les rotations. Parfois ça fonctionne, parfois pas. L’année dernière, nous avons essayé de cultiver de la cacahuète. Au vu de la technicité de la mise en place et surtout de la faible récolte, nous avons décidé que, pour le moment, nous ne pouvions pas l’implanter plus durablement dans nos champs. C’est à cela que ces essais nous servent : étudier la faisabilité de la culture de certaines plantes dans notre environnement. »
Pour faire voir ces expérimentations, l’équipe a mis en place une “parcelle d’essai” située devant la ferme et accessible à tous. « Étant donné que c’est sur le bord de la route, chacun peut s’arrêter et venir la découvrir. On avait envie, aussi, que ce soit une idée de sortie en famille afin de faire découvrir l’univers du végétal aux enfants. »
Sur 2 000 m², ils concentrent la culture de pas moins de 150 variétés de légumineuses, graminées, plantes méconnues, rares, voire insolites. Ainsi, cette année, on peut y trouver du pavot, du coton, du chanvre (« pour faire de l’huile » nous précise Hervé), du sorgho, de l’amarante, des haricots violets… qui, peut-être, si les essais sont concluants, seront cultivés à plus grande échelle l’année suivante.
« Chaque année, il y a des cultures qui ne fonctionnent pas. Pour diverses raisons, les aléas climatiques, les ravageurs… Nous le prenons en compte. Ça fait partie de nos prévisions qu’une culture ou deux n’aboutiront pas. C’est quelque chose qu’on apprend à accepter quand on est en bio. Cette année, il y a une parcelle de moutarde noire sur laquelle on ne récoltera rien ainsi qu’une parcelle de quinoa, alors que l’année précédente, on avait très bien réussi ces cultures. »
Les lentilles
Parmi les cultures phares de la ferme, la lentille représente un pan important de l’activité. « On a un rendement moyen à l’hectare de 800 kg. Cependant, en 2021, sur les lentilles vertes, on a fait 400 kg à l’hectare et zéro sur les lentilles corail et sur les lentilles noires. On a eu trop de flotte pendant l’été, les fleurs ont coulé, il n’y avait plus rien. Cette année, ça s’annonce bien. En moyenne, on commercialise chaque année 7 à 8 tonnes de lentilles vertes, 3 à 4 tonnes pour les lentilles corail et blondes et 2 tonnes de lentilles noires, aussi appelées lentilles beluga. Elle est moins connue, mais elle a un petit goût de noisette et elle est vraiment agréable à cuisiner. »
Et pour cause, la lentille reste une culture relativement facile : « elle est peu exigeante en termes d’éléments minéraux » et présente de nombreux atouts agronomiques, notamment celui de capter l’azote de l’air et de le retransmettre via ses racines au sol. « Elles vont aussi servir aux cultures suivantes. D’autant qu’on laisse les tiges et les enveloppes de lentilles qui vont se transformer en un humus riche en azote. C’est un engrais azoté naturel, sans pétrochimie. »
C’est d’ailleurs pour cette raison que cette légumineuse est souvent associée aux céréales. « La lentille est une semence de printemps, sauf la lentille blonde qui est une graine d’hiver. On la sème en octobre et on la récolte mi-juillet. Vu que son cycle est plus long, pour éviter que les adventices s’installent, on sème aussi une céréale pour couvrir le terrain avant l’hiver. Cette année, nous avons décidé de l’associer au seigle. Les lentilles se servent du pied comme tuteur. On avait fait des essais avec de la cameline. Mais la cameline est très poussante et elle pénalisait le rendement des lentilles. La lentille reste une petite plante de 30 à 40 cm. Il faut qu’elle puisse avoir de la lumière pour bien pousser. Comme pour toutes les légumineuses, elle va former une fleur, qui va ensuite donner une gousse renfermant 1 à 2 graines, puis, une deuxième fleur va repousser et, de nouveau, former une gousse contenant les graines. Et ainsi de suite sur plusieurs étages. En général, on compte 40 à 50 graines par pied. Nous les fauchons 3 à 4 jours avant la récolte pour qu’ils sèchent sur place. Les derniers étages qui sont à peine mûrs vont alors pouvoir finir de mûrir. Inévitablement, les graines seront un peu plus petites. Et c’est sans compter les gousses vides ! »

Vient ensuite le travail le plus long, celui du tri et de ses multiples étapes. « On utilise un combo d’outils. D’abord le trieur à grille et le trieur alvéolaire qui vont permettre de faire un tri selon la taille. On a tout un jeu de grilles pour s’adapter à chaque produit. Ça se joue au millimètre près. C’est pour ça aussi qu’on fait toujours attention de ne pas avoir deux cultures voisines qui auraient la même taille de graines. Ensuite, une fois ce premier tri effectué, on utilise la table densimétrique qui va répartir les graines selon leur poids et ainsi permettre d’éliminer les petits cailloux qui auraient la même taille que les lentilles. Les lentilles les plus légères vont aller aux animaux, le cœur de gamme est vendu à nos clients et les plus lourdes qui contiennent les cailloux serviront de semence. Si jamais nous avons besoin, nous pouvons aussi faire un tri avec le trieur optique de la CUMA à la Ferme de Rouillon, mais ça coûte cher, on préfère éviter ! »
Parmi les 4 lentilles proposées, Vivien d’Anjou a la particularité de commercialiser les lentilles corail non décortiquées. « La lentille corail est très sensible à la bruche, c’est un insecte qui va pondre dans les cultures. Sa larve va faire un trou de 1 mm dans la graine et donc être récoltée. Nous les trions 3 fois, une fois par mois durant les 3 mois qui suivent sa récolte. Grâce à la table densimétrique, les plus légères, attaquées par les bruches sont retirées. Si la plupart des industriels préfèrent les décortiquer, c’est pour qu’on ne voit pas que la graine a été colonisée par une larve à un moment donné. Nous, nous n’avons pas de décortiqueuse à lentilles. L’avantage de les utiliser non décortiquées est qu’elles vont mieux se tenir en cuisson, mais aussi présenter un niveau nutritionnel plus élevé avec leur enveloppe qui contient des fibres et des minéraux. On s’efforce donc d’expliquer à nos clients pourquoi on vend des lentilles non décortiquées. C’est de la pédagogie ! »


En effet, si aujourd’hui, les politiques publiques tendent à valoriser les lentilles, c’est notamment parce qu’elles représentent un intérêt nutritionnel certain, étant riches en fibres, protéines, minéraux et oligo-éléments. Pourtant, la consommation de légumineuses a chuté drastiquement au fil du XXᵉ siècle, passant de 7,3 kg/habitant/an en 1920 à 1,4 kg en 1985, quand sur la même période notre consommation de viande était multipliée par cinq.
En circuits courts
À la création du GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun), Thierry et Hervé ont fait le choix de lui associer une marque de commercialisation « On ne voulait pas commercialiser les produits sous le nom du GAEC Maine-Atlantique. Vivien, c’est le nom de ma grand-mère qui avait acheté la ferme à l’époque. On a ajouté la mention “d’Anjou” pour étoffer la chose. »
Au fur et à mesure des années, l’équipe a développé simultanément la gamme de produits, notamment en proposant diverses conserves artisanales de légumineuses et plats préparés — vendus en bocaux consignés dont ils délèguent la fabrication à une entreprise située dans la Vienne. Leur réseau de points de vente compte aujourd’hui quelques 150 boutiques et restaurateurs. « Nous avons la chance d’être à la limite de 4 départements et à 80 km de 4 grandes villes : Nantes, Rennes, Angers et Laval. Nous avons aussi remarqué que nos clients apprécient qu’on ne fasse aucune vente en grande distribution. »
À ces points de vente viennent s’adjoindre les artisans et conserveries qui transforment leurs produits et les acteurs de la restauration collective.
« On aimerait travailler plus avec les écoles. D’autant qu’ils ont tous désormais besoin de faire un repas végétarien par semaine. Mais ils sont pour beaucoup en appel d’offre et les contrats sont remportés souvent au moins cher et pas nécessairement au plus local et vertueux. »
Aujourd’hui, outre les 2 associés et leur salarié recruté en 2023 afin de prêter main forte à Thierry sur la gestion des cultures, l’équipe peut aussi compter sur le travail assidu de Valentine, chargée du développement commercial « C’est rare, des fermes qui embauche un commercial. » Outre la gestion, préparation et livraison des commandes, elle s’emploie aussi à démocratiser les différents produits de la ferme : « Nous avons pris l’habitude de faire des fiches avec des conseils d’utilisation que les magasins peuvent mettre à disposition de leurs clients. Nous savons qu’il faut accompagner les clients sur la prise en main de ces produits. Même sur les lentilles ! »