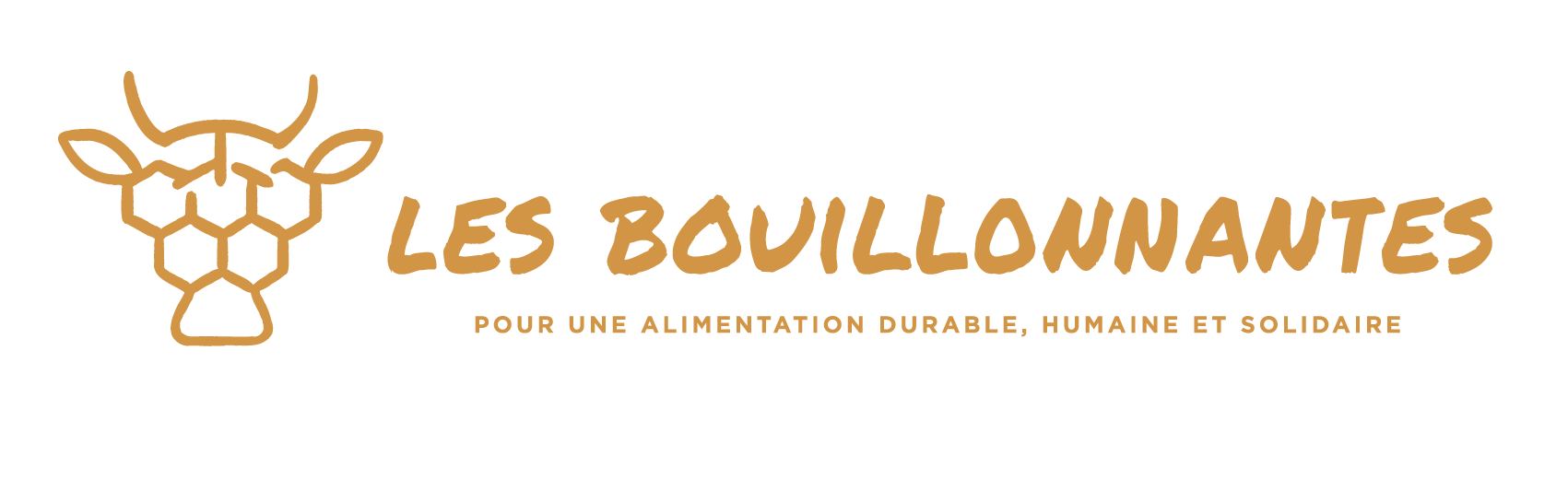- Posted: 16 septembre 2025
[La Grande semaine Végétale] Connaissez-vous (toutes) les céréales ?
Quand on parle de céréales, beaucoup d’entre nous pensent automatiquement au blé, au riz ou au maïs. Pourtant, le monde des céréales est bien plus vaste et fascinant qu’il n’y paraît. Du millet au sorgho, en passant par l’épeautre ou l’avoine, les variétés sont nombreuses tout comme leurs possibilités d’utilisations.
Cette diversité, souvent méconnue, offre une palette de goûts et de nutriments que nous consommons rarement dans nos assiettes. Explorer toutes les céréales disponibles, c’est découvrir un monde culinaire riche, mais aussi une manière de varier son alimentation pour le plaisir et la santé.
La richesse des céréales : au-delà du blé et du riz

Le blé occupe une place de choix dans le paysage agricole français. Le blé tendre (froment) est cultivé principalement pour la farine, tandis que le blé dur est lui réduit en semoule qui sert ensuite à fabriquer les pâtes. Les deux familles regroupent plus de 350 variétés de blé ! Selon qu’il soit complet, semi-complet ou raffiné, il offre des profils nutritionnels variés, avec des apports plus élevés en fibres et minéraux dans sa version complète.

Il existe aussi de très nombreuses variétés de maïs et ses utilisations sont nombreuses. En France, nous le consommons sous forme de semoule (polenta), de farine, de grains pour le maïs doux et plus rarement les épis frais. Cependant, une grande majorité du maïs cultivé sur notre territoire est principalement destinée à l’alimentation du bétail.

En France, on retrouve surtout l’avoine en cuisine sous forme de flocons, petits ou gros, dans les mueslis, les préparations de petit-déjeuner et pour donner du corps aux galettes et croquettes végétales. L’avoine est riche en fibres et rassasiante. Il peut prendre aussi la forme de farine, de grains soufflés ou de boisson végétale.

La culture du riz s’est développée à partir du XIXe siècle en France, principalement en Camargue. C’est une culture à part, qui nécessite des conditions très spécifiques : zone humide et ensoleillée, avec un système d’irrigation. Les variétés sont diverses, tant par leur forme (long, rond, complet) que par leur couleur (blanc, brun, rouge ou noir), offrant une large palette de goûts et de textures.

Le seigle est lui, surtout cultivé dans la partie nord de notre pays. C’est une céréale robuste adaptée aux climats frais et aux sols relativement pauvres. La farine de seigle est réputée pour sa richesse en nutriments, elle est utilisée pour fabriquer un pain dense et entre aussi dans la recette du pain d’épices auquel elle apporte une saveur légèrement acidulée et corsée.

Le millet est une céréale ancienne, cultivée en France, qui a beaucoup de qualités. Elle est rustique et peu gourmande en eau mais aussi très nutritive, sans gluten et originale avec son petit goût de noisette. En cuisine on peut utiliser le millet en grains à la manière d’une semoule, il faudra alors le cuire et l’égrainer. Il existe aussi sous forme de flocons pour épaissir une sauce ou enrichir une soupe.

L’épeautre, parfois appelé grand épeautre, est une variété ancienne du blé qui se distingue par sa saveur douce et légèrement noisettée. Il se consomme en grains, en farine pour le pain ou les pâtisseries, et même en flocons pour le petit-déjeuner. Il est apprécié pour sa digestibilité et sa richesse en protéines, tout en offrant une alternative intéressante au blé classique.

Le petit épeautre, ou engrain, est une variété bien distincte de l’épeautre classique. Cultivé traditionnellement dans certaines régions alpines, il possède une saveur encore plus délicate et légèrement sucrée. Ses grains, très fins, se consomment en farine ou en grains entiers et sont naturellement pauvres en gluten.

L’orge, autre céréale rustique, est traditionnellement utilisée pour les soupes, les potages et les préparations de type risotto ou salades. L’orge mondé conserve une grande partie de son enveloppe nutritive, tandis que l’orge perlé, plus tendre et rapide à cuire, est apprécié pour sa texture douce. On la retrouve aussi dans la fabrication de certaines boissons, comme la bière ou les cafés d’orge.

Le sorgho, autre céréale rustique adaptée aux climats secs, commence à être cultivé en France à petite échelle. Il se cuisine en grains ou en farine, dans des préparations salées ou sucrées, et constitue une alternative intéressante pour diversifier les régimes sans gluten.

Le blé khorosan ou kamut, variété ancienne de blé dur, ainsi que le teff, originaire d’Éthiopie mais cultivé ponctuellement dans certaines exploitations françaises, apparaissent dans des farines spécialisées ou des mélanges pour pains et pâtisseries. Ces céréales rares apportent saveurs et textures nouvelles, tout en contribuant à la diversité alimentaire.

Bien qu’il ne soit pas une céréale au sens botanique, le quinoa, originaire d’Amérique du Sud peut être cité d’autant qu’il est désormais cultivé à petite échelle en France et notamment dans les Pays de la Loire. Apprécié pour sa richesse en protéines et en nutriments, ses grains cuisent rapidement et s’intègrent facilement dans les salades, les plats chauds ou les porridges, apportant une texture légère et légèrement croquante.

Le sarrasin n’est pas non plus à proprement parler une graminée mais il y est apparenté de par ses utilisations et ses qualités alimentaires, on l’appelle d’ailleurs communément « blé noir ». Très riche en fibre et nourrissante, la farine de sarrasin est bien sûr utilisée pour fabriquer les galettes bretonnes mais elle peut aussi entrer dans la composition de recettes classiques, apportant ainsi son rustique, légèrement amer. Le sarrasin est aussi utilisé en cuisine en grains décortiqués cuits, en accompagnement comme une céréale. Le kasha est sa version torréfiée, plus corsée en goût.
Céréales hybrides ou anciennes ?
Au fil des siècles, l’être humain a sélectionné les céréales pour améliorer rendement, résistance et qualité. Cette sélection a donné naissance à deux grandes catégories : les variétés hybrides, modernes, et les variétés anciennes ou populations, plus traditionnelles.
Les céréales hybrides résultent de croisements contrôlés entre lignées spécifiques. Elles offrent une grande uniformité et des rendements élevés, ce qui les rend incontournables dans l’agriculture industrielle. Cette performance est un atout pour nourrir une population mondiale croissante, mais elle réduit la diversité génétique et peut rendre les cultures plus vulnérables aux maladies et aux aléas climatiques.
À l’inverse, les variétés anciennes, souvent appelées « populations » ou « céréales paysannes », sont issues de semences qui se reproduisent naturellement. Elles présentent une diversité génétique importante, et leurs cultures ont un impact environnemental moindre de par leur diversité mais aussi car elles s’adaptent à des conditions climatiques peu favorables, voire rigoureuses, et sont souvent peu gourmandes en eau. Elles ont l’avantage de nécessiter peu d’intrants et sont donc tout à fait appropriées à une agriculture biologique. Leur goût, souvent plus complexe et moins uniforme, offre également une richesse sensorielle que l’on retrouve rarement dans les céréales modernes.
Généralement le recours aux variétés anciennes s’accompagne d’une pollinisation libre. La pollinisation libre consiste à laisser les mécanismes naturels (insectes, oiseaux ou vent) polliniser les fleurs. Une grande diversité génétique résulte de cette dissémination sans restriction aucune du pollen parmi tous les plants d’une variété à pollinisation libre. Cette plus grande variation au sein des populations végétales permet aux plantes de s’adapter graduellement aux variations climatiques et aux différents biotopes cultivés d’une année à l’autre. Ces graines peuvent être ressemées d’une année sur l’autre en donnant à chaque fois des descendants identiques aux parents.
À l’inverse, les semences hybrides F1 sont délibérément créées par une méthode de pollinisation contrôlée pour obtenir des caractéristiques précises : une meilleure tolérance aux maladies, un fruit plus résistant à la manutention, une maturité uniforme pour faciliter la récolte commerciale, etc. Les graines issues de plantes « F1 » produisent des descendants différents des parents : le semis n’est pas fidèle, la variété est instable. Il faut donc généralement racheter des graines pour les semis de l’année suivante.



Varier les céréales dans notre alimentation
Varier les céréales dans notre alimentation n’est pas une simple question de gourmandise : c’est un choix à la fois…
…pour notre santé, chaque céréale apporte un profil nutritionnel unique : l’avoine, riche en bêta-glucanes, aide à réguler le cholestérol ; le millet fournit magnésium et antioxydants ; le sarrasin, naturellement sans gluten, contient des flavonoïdes bénéfiques pour le cœur. Consommer plusieurs types de grains permet donc de bénéficier d’un éventail plus large de nutriments essentiels.
…pour l’environnement, diversifier les cultures protège la biodiversité agricole et réduit la dépendance à une poignée de variétés dominantes. Les pratiques de diversification favorisent également des sols plus sains et une agriculture plus résiliente face aux changements climatiques.
Ainsi quelques gestes simples peuvent avoir un impact significatif : alterner le blé avec l’épeautre ou le seigle pour le pain et les pâtes, introduire le millet, le sorgho ou le quinoa dans les salades, risottos ou porridges, choisir des produits paysans issus de variétés anciennes pour soutenir la biodiversité et les producteurs locaux, expérimenter ses recettes habituelles avec des farines variées pour les pâtisseries ou les pains faits maison.
Connaître toutes les céréales est un voyage sans fin. Chacune raconte une histoire, reflète un terroir, et révèle des saveurs propres. À travers elles, c’est notre rapport à l’alimentation qui se transforme : moins uniforme, plus attentif, plus riche, plus durable.